
|
|
|
|


 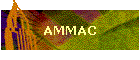  
Depuis des siècles, Bastia est une ville de garnison. Ce mémoire, réalisé par un stagiaire de l'IRA, permet d'en retracer les grands moments. Un grand merci à Élisabeth JOUGLA pour son concours.
BASTIA, VILLE DE GARNISON
Réalisé par Élisabeth JOUGLA, Élève - fonctionnaire de l’Institut Régional d’Administration de Bastia, en stage à la Délégation Militaire Départementale de la Haute-Corse.
PROLOGUE Cette étude réalisée au cours de la période du stage long du cursus de formation à l’I.R.A n’a pas la prétention d’être un document exhaustif mais seulement le fruit d’une synthèse de différentes archives. L’histoire militaire de Bastia étant liée à l’histoire de la Corse, ce document aborde les aspects politiques et historiques des faits qui la marquèrent. Ainsi l'aperçu des événements qui jalonnèrent l’histoire de l’île, permet de mieux aborder l’histoire des troupes à Bastia et en Corse. Cette première étude pourra être utilement complétée par d’autres recherches, plus approfondies, notamment dans les archives du Service Historique de la Défense, de la Direction de la Mémoire du Patrimoine et des Archives ou encore auprès de la Collectivité Territoriale de Corse. Je tiens à adresser mes plus chaleureux remerciements au Major (H) Guy LIMONGI de Bastia, président de l’association des gendarmes retraités et gendarmes anciens combattants de la Haute Corse, pour son aide précieuse. En outre, je remercie également la Mairie de Bastia, et notamment la Direction du Patrimoine, pour son prêt de l’ouvrage concernant le Couvent Sant’ Angelo. Sans leur disponibilité et leur aide, je n’aurais pu réunir toutes ces informations multiples et variées, indispensables à la réalisation de ce document. La couverture photographique des sites militaires de Bastia a été effectuée par le Major (H) Guy LIMONGI, le major ® Alain LAUDUIQUE et l'adjudant Sylvie MAURIZIO de la Délégation Militaire Départementale de la Haute-Corse. Merci également aux délégués militaires, les lieutenants-colonels Georges BENINTENDI et Gérard LIEBENGUTH pour leur soutien et la relecture de cet ouvrage.
SOMMAIRE I. L’ordre de fer génois
II. Le XVIIIème siècle et ses révolutions : Gênes cède la place au royaume français
III. La révolution de 1789 : une nouvelle aube se lève pour la Corse
IV. Du Directoire à la Corse contemporaine
BASTIA, Ville de Garnison Parler de l’histoire militaire de Bastia, et plus précisément de la présence de l’armée à Bastia et dans la Citadelle, ne peut se faire sans brosser un tableau des évènements historiques qui marquèrent l’île. Bastia, dont l’existence remonte au XIVème siècle, est une place génoise choisie pour favoriser les relations commerciales avec Gênes et garantir la sécurité des gouverneurs. Bastia, et plus précisément la Citadelle, voit le jour sur l’emplacement d’un site fortifié. En 1380, Leonello Lomellini, membre de la Maona, cartel financier à qui Gênes avait délégué ses pouvoirs, bâtit le "castello della Bastia". Bastia, resta pendant longtemps un modeste château, qui occupait vraisemblablement l’angle nord ouest de l’actuelle Citadelle. Jusqu’à la moitié du XVème siècle, on ne parle que d’un castrum bastitaë, dont le potentiel militaire est réduit : 4 bombardes, 7 arbalètes à tour, 2 à rouet, 8 à moufle, 1 épingard, 3 sarbacanes, des lances et des casques. En 1453, sous l’Office Saint Georges, forme de «cartel capitaliste» disposant d’une délégation de pouvoirs de la République Génoise, les tours littorales de guet et les citadelles de Bonifacio et Bastia furent construites. En 1476, des maisons se construisent, constituant ainsi le premier noyau de la ville dénommé Terra Nuova, en opposition à Terra Vecchia, bourg situé en dehors de l’enceinte. Au sud, un fossé (fosso) assurait la protection des lieux. Il se situait au-dessus du vieux port de l’époque (porto vecchio ou anse de Figajola actuelle), à l'emplacement de nos jours du parking de la place d’armes.
La physionomie de la ville de Bastia a beaucoup changé au fil des siècles. Elle n’a plus rien à voir avec la Terra Nuova et la Terra Vecchia des XIVème, XVème, XVIème et XVIIème siècles. Ainsi, parler de l’histoire militaire de cette ville ne peut se faire qu’en abordant également les différentes époques qui l’ont façonnée, transformée et ce dans le contexte historique de l’île. L’armée, installée dans les forts et bastions, les a progressivement quittés, mais demeure implantée en Corse sur d’autres places et d’autres lieux.
I. L’ordre de fer génois. A. Cinq siècles de présence génoise dans l’île. C’est à l'époque de l’occupation génoise que la ville de Bastia et sa citadelle furent érigées. En effet, dès la fin du XII siècle, Gênes manifesta sa volonté de prendre position en Corse, notamment en raison de sa position géographique sur la route du commerce avec l'Orient. Cette occupation génoise fut mal vécue, et à maintes reprises le peuple corse tenta de la briser. C’est en 1195 que la République Ligure s’empare de Bonifacio et que débute l’expansion génoise en Corse. En 1282, la Corse tombe aux mains des génois suite à la victoire navale remportée sur Pise. Dans la seconde moitié du XIIIème siècle, la République de Gênes possède une grande partie de l’île (l’En-Deçà-des-Monts) et dispose de deux solides forteresses : Calvi et Bonifacio. Ces deux villes sont les deux clefs de la puissance ligure en Méditerranée. Au fil des siècles, elles ont démontré leur courage et sont apparues comme des places souvent inaccessibles et inexpugnables car très bien défendues. Il restait à la République de Gênes à conquérir l’Au-Delà-Des-Monts, plus tard appelé le Liamone, l’actuelle Corse du Sud. Suite de la construction de la Bastille, le gouverneur Génois s'installe à Bastia, la préférant désormais à Biguglia. En 1575, la Citadelle est fortifiée ; en effet, c'est à partir de cette époque que date la construction des Bastions, et notamment le Bastion Saint Jean Baptiste (achevé en 1578) qui est désormais situé au dessus de la place d'armes actuelle et du cours du Dr Favale, à côté des portes de la ville. En 1595 et 1596, sont édifiés respectivement les bastions Saint Charles et Sainte Marie. Le Bastion Saint Charles étant très certainement situé là où le premier château a été construit, le "fortino". Le Bastion Sainte Marie qui fait face au Sud, est celui situé en face de la route du front de mer et de l'anse de Figajola, afin de repousser les attaques de l'intérieur de l'île. Arrêtons-nous un instant sur une présentation du Donjon et de ses annexes qui sont le véritable berceau de la ville. Ses armes sont "d'Azur au Donjon d'Argent". Le siège du gouvernement a été jusqu’au début du XVIIIème siècle (fin de la période génoise) installé dans ce Donjon. Et l'œil de la ville a longtemps été la piazza di corte, soit la place du Donjon. La cour intérieure du Donjon a été construite sur une citerne pour ravitailler en eau, la ville et la caserne. Un vaste four a été édifié. C'est probablement vers 1488 que sont achevés les murs, la citerne et la salle du Gouverneur. La tour ronde, que l'on appelle encore l'horloge, a été restaurée au XVIIIème siècle. C’est aussi dans ce donjon, au-dessous du Château, que furent internés de nombreux prisonniers de droit commun ou politique. En effet, les geôles de la bâtisse situées en contrebas, pourtant dotées de nom de rêves (le purgatoire, le paradis) étaient de véritables cachots où furent enfermés des hommes illustres tels que Sampiero Corso, Giafferi…
Au cours des XVIIIème et XIXème siècles, l’ensemble de la fortification du Donjon a été transformé en magasins et en chambrées.
A l’époque des Génois, le Palais des Nobles Douze était situé à côté du Donjon, sur les arcades, à gauche de la porte restaurée sous le règne de Louis XVI. C'était le lieu de réunion du Conseil des Douze puis du Conseil Supérieur après la conquête française. Sous le Second Empire, c'est là que siégeait le Conseil de Guerre pour devenir XIXème siècle, le bâtiment du Génie Militaire.
Au XIXème siècle s'installe dans un bâtiment, à droite de la porte Louis XVI, la Direction d'Artillerie, à côté du Palais des Gouverneurs et du bastion Saint Jean. Ce bâtiment a ensuite été le siège de l’Etat-Major de la 55ème division militaire territoriale. Puis, il a hébergé la Délégation Militaire Départementale de Haute-Corse, le Transit Interarmées et le Centre d'Information et de Recrutement de l'Armée de Terre avant d'être cédé à la municipalité de Bastia en juin 2005.
Jusqu’au XVIème siècle, sous les différentes dominations qui pèsent sur l’île, les Corses furent associés au dispositif militaire des occupants et admis aux charges militaires subalternes. On assista à l’instauration d’un système mixte d’autodéfense qui utilisait les Génois issus des villes et les ruraux autochtones. A titre d’exemple, à la fin du XVIème siècle, la garnison de Bastia se composait de mercenaires suisses ou italiens. Elle comprenait un capitaine de la garde, 12 chevau-légers, 1 adjudant de place, 2 capitaines d’escadrons, la cavalerie, l’artillerie. Ces deux dernières armes étaient composées d’Allemands. Il y avait 30 soldats garnisaires, 20 canonniers, 8 bombardiers, 3 adjudants d’artillerie. En outre, il y avait une escorte de sbires pour accompagner les collecteurs d’impôts qui parcouraient le pays.
Et si aux siècles précédents, les gardiens des tours (ou les torregiani), étaient recrutés parmi les insulaires, au XVIIème siècle (vers 1636), ces derniers, ainsi que les gardiens de postes militaires furent recrutés essentiellement parmi les Génois. Ainsi, les Corses furent également interdits de charges publiques autres que militaires.
La vie civile et privée fut soumise aussi à des restrictions : le droit au port d’armes fut de plus en plus restreint, puis supprimé en 1711 pour les Corses. Cependant la pratique de la vente par les autorités génoises de permis exceptionnels de détention d’armes à feu perdura jusqu’à la fin du régime de la Sérénissime République ; en contrepartie la contrebande officieuse de fusils se développa.
B. L'Office Saint Georges. Ces engagements dans des troupes continentales contribuent à amplifier les migrations corses. L’une des figures marquantes de cet engagement est Sampiero Corso. Ce personnage qui s’est illustré sur différents champs de bataille, est l'un des premiers à avoir donné à l’île une dimension nationale. C. Le XVIème : 1ère victoire de l'armée française sur l'armée génoise.Ce siècle est marqué par le courage et la bravoure de Sampiero Corso. Après avoir servi dans la garde pontificale, il a longtemps servi dans les armées françaises en Provence, dans le Sud et jusqu’en Turquie. Il voulait que la Corse se débarrasse du joug génois et soit rattachée au Royaume de France. Les Génois ayant mesuré le danger qu'il pouvait représenter, il fût enfermé en 1516 dans les cachots du Donjon par le gouverneur de la République de Gênes. Sous la pression de François Ier et des ambassadeurs envoyés à Gênes, il fût libéré. En 1551, Sampiero voulut conquérir la Corse et il fit appel à Henri II, alors Roi de France, qui avait compris l'importance stratégique de l'île. Le Roi de France, aidé du Grand Sultan, prend aisément position dans de nombreuses villes, à l’exception de Calvi. Gênes riposte, et avec l'aide du duc de Milan reprend Bastia en 1554, puis Saint Florent. Le conflit s’enlise et prend des aspects de plus en plus politiques. En avril 1559, le Roi de France Henri II, abandonne la Corse en signant le Traité de Cateau-Cambrésis, à la grande déception des insulaires. Dès lors, Gênes a le champ libre et fait régner une sévère répression sur l'Ile. Sampiero continua à se battre à l'intérieur des terres. Il fut tué en 1567 lors d'une embuscade génoise. De cette époque jusqu'à 1729, le siècle de fer régna en Corse. C'est une période où toutes les insurrections furent mâtées et où l'ordre de fer génois fût des plus prégnants. D. Le XVIIème : siècle de l’édification de bâtiments religieux.Il est important de présenter l’évolution des bâtiments qui d’édifices religieux devinrent au fil des siècles des bâtiments militaires. Les bâtiments situés à la Citadelle (Terra Nuova) : D’après l’historien Banchero, le couvent des Clarisses (Sainte Claire d’Assise) situé à la Citadelle, jouxtant l’Église Sainte Marie, fut édifié vers 1600. Devenant bien national pendant la période révolutionnaire, il fut occupé par le génie militaire pour, vers 1818, être transformé en maison d’arrêt. Un entrepreneur privé le rachète en 2003 afin d'y établir un hôtel.
Approuvé en 1613 par le Pape Clément VIII, le couvent des Turchines, bâtiment parallèle à l’Évêché et au Séminaire, remonte au XVIIème siècle. Après avoir été bombardé par les anglais en 1794 lors du siège de la ville qui était restée aux mains des français, les religieuses furent recueillies par les clarisses pour y être intégrées. Le couvent, depuis la révolution, a été occupé par la troupe. Dès la révolution, l’ancien Évêché a lui aussi été occupé par le Génie militaire ; actuellement il abrite la Délégation Militaire Départementale de Haute-Corse et le Transit Interarmées depuis le début de l’année 2003.
Le Séminaire contigu a servi de magasins pour la troupe, puis de ménage pour les sous-officiers et de logements cadres au début du XXème siècle pour être finalement mis en vente comme appartements. Les bâtiments situés dans la Terra Vecchia :
Ces deux couvents étaient dotés d’une pharmacie bien fournie et pouvaient accueillir et soigner de nombreux malades.
II. Le XVIIIème siècle et ses révolutions : Gênes cède la place au royaume français. Ce siècle est riche en évènements majeurs pour cette île de plus en plus connue en Europe qui est sortie d'un système moyenâgeux, archaïque pour s'ouvrir aux Lumières. On peut reprendre la formule de Chateaubriand "l'histoire du peuple n'est qu'une longue échelle de misère dont les révolutions sont les degrés". Pour la Corse, ce siècle des Lumières fut le plus porteur ; il consacra la fin de l'occupation génoise, voire pour certains, de l'oppression génoise. L'île s'est affirmée sur l'échiquier européen. La Corse connu trois révolutions principales méritant d'être abordées. A. La guerre de 40 ans : 1729-1769.Après la mort de Sampiero Corso qui avait bien cristallisé la volonté des Corses de se détacher de la République génoise, les habitants de l'île vécurent dans la misère et la pauvreté. C'est principalement au XVIIème siècle que les clivages riches/pauvres s'accentuèrent. Parallèlement, les villes comme Ajaccio, Bastia, Calvi se développèrent. Au début du XVIIème siècle, Bastia comptait 6 à 8 000 habitants. A la fin du XVIIIème siècle, on en recense environ 10 000. Sampiero, comme Vincentello en 1408, avait révélé l'existence d'une forme de sentiment national fort chez les habitants de l'île, sentiment accru puisque durant le siècle de fer, l'ordre génois avait plus profité à Gênes qu'aux autochtones. La première révolte populaire de 1729 ne fut que l'aboutissement d'années de souffrance et d'oppression. D'après les faits historiques de cette époque, la rébellion a démarré suite à la demande génoise formulée à un paysan du canton de Bustanico, dénommé Cardone, d'acquitter le "dui séini" un nouvel impôt local de la République. Ce dernier refusa et les révoltés s'enhardirent. Le gouverneur de l'île envoya des troupes pour les réprimer. Les troupes des révoltés joignirent Bastia et la guerre de 40 ans débuta. Les notables vont prendre le commandement, notamment Hyacinthe Paoli, père de Pascal. Les bandes des insurgés furent organisées par les officiers corses revenus dans l’île après avoir servis en Europe afin de constituer une véritable armée nationale qui fut dotée d’un drapeau, d’un hymne et d’unités. La première compagnie corse fut mise en place par Pompiliani, officier provenant du service napolitain. Elle récupéra des armes grâce à la contrebande britannique, française et livournaise, et grâce aux désertions. En février 1730, les habitants de la Terra Vecchia de Bastia assiégèrent la Citadelle. Gênes demanda l'assistance de l'empereur d'Autriche qui envoya 8 000 hommes. Les austro-génois pensèrent que la révolte serait brisée. Or, en 1732, de nouvelles troupes (11 000 hommes) furent envoyées en Corse sous le commandement du duc de Wurtemberg. En 1735, le mouvement des insurgés prit une toute autre dimension car c’était l’indépendance qui était réclamée. La Consulte (assemblée populaire) de Corte est signée marquant la volonté des insulaires de rompre avec Gênes. En 1736, lorsque Théodore de Neuhoff est intronisé Roi de Corse, il crée un embryon de corps réguliers, composés de miliciens et vêtus du costume local des paysans. Dans chaque paroisse, des compagnies de 200 hommes furent créées. L’encadrement était formé d’un capitaine, de deux lieutenants et de deux aides ou cadets. Un bataillon commandé par un colonel ou commandant fut créé par piève ou canton. Le Roi, d’après les propos de Jacobi, était le généralissime de l’armée, et les généraux de la nation lui servaient d’aide de camp et de ministres. Les milices demeurèrent l’élément constructif des corps de bataille. Après l’intermède "bouffon" de Théodore de Neuhoff, la République de Gênes décide de faire appel à la France.
LA PREMIERE INTERVENTION FRANCAISE. L’armée française avait pour mission d’assurer et de garantir l’ordre et la paix dans l’île. En février 1738, un corps expéditionnaire de 3 000 hommes sous le commandement du Général, comte de Boissieux, débarqua à Bastia. Ce dernier était en charge d’une mission de conciliation, de médiation et d’arbitrage pour ramener les habitants à l’obéissance. En mars 1739, le Marquis de Maillebois le remplaça avec 12 000 hommes pour éteindre toute rébellion. Hyacinthe Paoli et d’autres chefs populaires furent exilés afin de ramener la paix et l’obéissance des Corses aux Génois. Durant cette période, sous le règne de Louis XV, le lieutenant général de Maillebois crée un régiment recruté en Corse, passé à la postérité sous le nom de Royal Corse. Par ordonnance du 10 août 1739, ce régiment est composé de dix compagnies. Il sera le creuset de nombreux jeunes chefs corses qui apprendront à se battre pour le roi de France. Ce Royal Corse fut un véritable instrument de rapprochement entre la France et la Corse. En effet, le recrutement fut essentiellement un regroupement d'insulaires corses bannis par les Génois, même si au début coexistaient Corses et italiens. Les compagnies constituées devaient aller servir le roi sur le continent. On les retrouve dans les garnisons d’Antibes, Oléron, Fort Barraux, Fort Montdauphin, Toulon, Avignon et Marseille. En 1762, le Royal Corse est incorporé au Royal Italien dont il forma le deuxième bataillon. Avril 1763 marqua la dissolution du Royal Corse. En 1765, à la demande des officiers corses, ce régiment fut reconstitué à un bataillon. En avril 1775 le Royal Corse est porté à deux bataillons en y incorporant 9 compagnies d’infanterie de la Légion Corse. Une ordonnance du 17 mars 1788 prononça sa dissolution et ce régiment fut remplacé par deux bataillons : chasseurs royaux corses et chasseurs corses. En 1772, fut crée le Régiment Provincial Corse pour le maintien de l’ordre et l'appui de la Prévôté. Il perdura jusqu’en 1791, date de création de la Gendarmerie Nationale, dans laquelle il fut absorbé et intégré. La juridiction prévôtale était installée à Bastia. Maillebois s’efforça de convaincre la Cour de France de se substituer à Gênes pour administrer l’île. Mais la République ne voulait pas céder sa place. Mai 1741 signa la fin de la première intervention française. Lors de la consulte d’Orezza en août 1745, le premier gouvernement de l’île est ébauché, ayant pour conséquence la reprise des tensions entre l’île et la République. En 1745, Bastia est bombardée par des vaisseaux anglais au service du Roi de Sardaigne. Attaqué de l’intérieur, le Gouverneur génois s’enfuit. Mais l’Angleterre, pour des raisons politiques se retire de l’île. LA SECONDE INTERVENTION FRANCAISE. Appelée par Gênes en 1748, la France intervient pour la seconde fois. Le Marquis de Cursay doit veiller à ce que l’entente corse/génoise s’établisse. Les français repartent en 1753. B. Pascal Paoli prend la tête de l’insurrection. Le 13 juillet 1755, lors de la Consulte de St Antoine de Casabianca, Pascal Paoli est désigné « Général de la Nation corse et de l’Immaculée Conception en son royaume de Corse » suite à une réunion de 16 pièves (cantons). Prenant la tête de l’insurrection, il a contre lui les habitants des villes, restés fidèles au pouvoir génois légitime. En parallèle, on assiste à une montée en puissance du parti français, né sous Henri II, et fortifié par Maillebois en 1739. En 1764, Pascal Paoli a obtenu l’unité de la Corse à l’exception des grandes villes, et a tenté d’établir l’ordre notamment en mettant en place une justice impitoyable qui en 24 heures pouvait condamner à mort un assassin. Cette terreur, appelée la « Guistizia Paolina », tentait de lutter contre la Vendetta, pratique qui s’était installée dans l’île quelques siècles auparavant, et avait été encouragée sous l’Office de Saint Georges. Pascal Paoli organisa également un véritable système militaire. Le principe du service militaire obligatoire mis en place précédemment fut maintenu. En 1762, une ordonnance militaire réglemente l’organisation du service militaire, dû par tous les hommes de 15 à 60 ans. Le volontariat était de rigueur, mais si les effectifs s’avéraient insuffisants, on procédait à un tirage au sort : les recrues ainsi désignées effectuaient un an de service dans l’armée active et deux ans dans les réserves. Paoli fit appel à des officiers corses au service d’armées du continent pour mettre sur pied son armée. Les forces armées de terre étaient divisées en deux parties :
Néanmoins, Paoli demeura longtemps opposé aux troupes de métier : « dans un pays qui veut être libre, il faut que chaque citoyen soit soldat et qu’il se trouve toujours prêt à s’armer pour la défense de ses droits. Les troupes disciplinées conviennent mieux au despotisme qu’à la liberté. Rome cessa d’être libre le jour où elle eut des soldats payés et les invincibles phalanges de Sparte étaient formées de la levée en masse. » L’organisation militaire reposait sur les milices communales. La commune était administrée par un podestat assisté de deux pères des communs, élus au suffrage universel. Dans chaque commune on trouvait un capitaine d’armes (ou chef d’armes ou maître d’armes) qui était recruté parmi les anciens militaires du service étranger et nommé par la consulte nationale. Ce chef d’armes était responsable de l’instruction des recrues, du maintien de l’ordre dans la commune et de l’exécution des jugements. La tenue des miliciens était le costume typique des corses du XVIIIème siècle. En sus, Paoli décida de mettre en place en 1755, deux régiments de 400 hommes chacun, composés de soldats de métier à la charge de l’État. En 1768-1769, lors de la campagne, des historiens ont fait référence à des troupes de mercenaires étrangers, constituées de Suisses et d’Allemands. Ces derniers ont pris part à la bataille de Ponte Nuovo en mai 1769 contre les troupes françaises (Jacobi y fait référence dans son ouvrage "l’histoire générale de la Corse"). D'autre part Pascal Paoli fonda le port d'Ile Rousse comme port militaire et arsenal et voulut créer une véritable marine nationale. Il faut rappeler la victoire de l’opération amphibie menée en 1767, qui permit de battre la flotte génoise et d’obtenir ainsi la capitulation de la garnison génoise de l’île de Capraia. Ce mouvement corse aspirant à l’indépendance a suscité de l’intérêt dans les capitales européennes. J.J. Rousseau lui-même a soumis un projet de constitution à Pascal Paoli. Mais les villes comme Bastia, Calvi, Bonifacio, protégées par leurs remparts, se sont avérées imprenables. Les ports demeuraient toujours occupés par les Génois. En 1756, Choiseul, nouveau ministre des affaires étrangères du Roi de France, ambitionna, également de supplanter Gênes dans sa souveraineté sur la Corse et se proposa pour l'aider dans sa lutte contre l’insurrection corse.
LA TROISIEME INTERVENTION FRANCAISE. Encore une fois au cours de ce début du XVIIIème siècle, Gênes fait donc appel à une puissance tierce, en l'occurrence le Royaume français. En 1764, la France va occuper les places de Bastia et Algajola, après celles d’Ajaccio, de Calvi et de Saint Florent en 1756. Cette situation résulte de la signature des deux traités de Compiègne. Les troupes royales sont placées sous le commandement du Marquis de Castries, et plus tard, du comte de Vaux. En 1759, la guerre de 7 ans faisant rage en Europe, la France, ayant besoin de renfort, rappelle ses troupes positionnées en Corse. A signaler que le deuxième traité de Compiègne de 1764, met en place une disposition quant à la présence des troupes militaires françaises en Corse : celles-ci doivent s’installer pour quatre années en Corse afin de la pacifier et d’établir la médiation entre les Corses et les Génois. C. Le traité de Versailles de 1768 et la campagne qui devait décider du sort de l’île.En 1768, à l'issue des quatre années de présence des troupes françaises, Gênes, redoutant de nouveaux affrontements, préconise l'évacuation de l’île. Le 15 Mai 1768 est signé le Traité de Versailles, que d’autres ont appelé le Pacte de Versailles. Par cet acte, la Sérénissime République de Gênes a procédé à la cessation de sa souveraineté ; d'autres y virent la vente de l’île à la France. Dans ce traité, il est stipulé que les places ou forts occupés par les troupes du Roi seront gouvernés par Sa Majesté, qui y commandera en souverain. Gênes a donc cédé sa souveraineté à la France. L’île va vivre désormais au rythme de la Nation française. La période des années 1768-1769 a été primordiale dans l’histoire de l’île, puisque ce sont affirmés et confrontés avec force les idéaux visant à transformer la colonie en une province, ou visant à rendre la Corse indépendante et seule souveraine. En 1768, la nouvelle de la cession de la Corse à la France indigna toutes les classes sociales et contribua à développer un farouche patriotisme sous la direction du général Pascal Paoli. Une résistance sérieuse s’était organisée. Les troupes françaises de l’île ont été renforcées par un corps expéditionnaire de Chauvelin (ex-ambassadeur de France à Gênes) qui débarque à Bastia avec 12 000 hommes. En 1768, le Royal Corse tenait garnison au Fort Barrault (situé sur le continent). Le colonel propriétaire était le Marquis de Luc. Le colonel commandant était Buttafuoco. Louis XV, alors roi de France, avait eu l’idée d’envoyer ce régiment en Corse pour y combattre les patriotes qui défendaient leur indépendance et leur liberté. Les officiers, le lieutenant-colonel Marengo en tête, déclarèrent que si un tel projet était exécuté, ils enverraient leur démission au Roi : les troupes restèrent sur le continent ! En avril 1769, Choiseul décida d’envoyer une puissante armée de 27 000 hommes commandée par le maréchal Jourda de Vaux et soutenue par une artillerie conséquente. Elle débarque à Saint Florent. Le général des Corses tenait à s’emparer coûte que coûte des quartiers militaires d’Oletta afin de pouvoir tenir en échec les garnisons de Bastia et de Saint Florent. Le poste de l’armée était défendu par les troupes du marquis d’Arcambal. Malgré l’occupation française, les habitants d’Oletta (de farouches patriotes) avaient entrepris de faire pénétrer dans le village des troupes corses pour repousser l’envahisseur et surprendre l’armée française endormie. A leur tête, se trouvaient l’abbé François Antoine Saliceti, l’abbé Leccia et des notables. Arcambal fut mis au courant de cette conspiration. Les conjurés furent arrêtés et conduits à Bastia pour y être jugés. Paoli se décida alors à attaquer, mais l’armée française nombreuse et imposante les écrasa. Paoli dû abandonner le Nebbio. Le 9 mai 1769, le combat de Ponte Nuovo mettait fin à la campagne et décidait du sort de la Corse. En juin, la consulte de Corte prêta serment de fidélité au roi de France. Cette affaire fut néfaste pour la cause de l’indépendance corse et Pascal Paoli se réfugia en Angleterre. En août 1769, la Légion Corse fut créée. Elle était articulée en 17 compagnies formées à Tarascon. Deux compagnies servirent de dépôt, l’une en l’En-Deçà-des Monts, l’autre dans l’Au-Delà-des Monts : les fantassins étaient Corses et les dragons étaient tous français. Cette légion fut créée pour fournir un métier aux Corses qui étaient présentés au Roi Louis XV comme un peuple de guerriers. D’après un extrait du document qui fut présenté au travail du Roi par les ministres de Louis XV, il est signifié : « Le seul métier des Corses et leur unique ressource pour vivre est le port des armes. Leur oisiveté pouvant devenir dangereuse au bon ordre et à la santé publique, il semble qu’il est convenable de les attacher au service du Roi». Durant la campagne qui avait fait rage dans l’île en 1768-1769, les troupes légères avaient été rudement menacées par les insulaires qui avaient agi d’instinct et s’étaient battus en tendant des embuscades prouvant la qualité de leur résistance au combat. La Légion Corse n’eut jamais l’occasion de combattre, ni de servir en Corse. En 1775, elle fut incorporée dans le régiment Royal Corse et fut baptisée Légion du Dauphiné. Elle eut le Marquis d’Arcambal comme brigadier et colonel propriétaire. Son colonel commandant était monsieur de Guibert qui sera le responsable de sa dissolution. Ponte Nuovo marque la fin de la guerre de 40 ans ou d’indépendance. En 1769, c’est le général comte de Vaux qui assure le commandement du corps expéditionnaire, plus nombreux et mieux armé, ce qui oblige les insurgés à abandonner Ponte Nuovo. Resté en Corse, il devient le gouverneur, mais il veut éradiquer trop violemment le banditisme qui sévit sur l’île. En mai 1770, il démissionne pour être remplacé par le général comte de Marbeuf, en Corse depuis 1764. Ce nouveau gouverneur de l’île va lui aussi procéder à une mise au pas très sévère de la Corse, son principal souci étant d’intégrer l’île au Royaume, de l’assimiler complètement. Cependant, seules les grandes villes comme Ajaccio ou Bastia comptent de nombreux partisans pour la France. Les institutions demeurent identiques aux précédentes : les consultes (assemblée populaire où les habitants désignent leurs représentants, les podestats (les maires), les pères du commun (responsables de la police et de la justice de paix). Durant ces années 1770, sous le règne de Louis XV, la noblesse corse fut reconnue et le régime essaya d’encourager et de permettre les vocations militaires ; en définitive poursuivre l’ancienne tradition insulaire de service du Royaume français, existant depuis Sampiero. De nombreux jeunes insulaires accédèrent aux écoles militaires du continent (Napoléon Bonaparte en est issu). III. La révolution de 1789 : une nouvelle aube se lève pour la Corse. Les idées de la Révolution en Corse ne purent qu’y être accueillies favorablement, même si la création de la Garde Nationale a provoqué dans les villes comme Bastia une levée de boucliers cristallisant le mécontentement de certains, celui-ci fût bref. A . La Corse fait partie de l’Empire français. Tout d’abord, se tient le vote à l’Assemblée Nationale du décret historique du 30 novembre 1789, présentés par des députés corses, notamment Saliceti, qui déclare « La Corse fait partie de l’Empire français, et ses habitants doivent être régis par la même Constitution que les autres français ». Cela marque la consécration d’une union Corse-France indissoluble. Grâce à ce décret, Pascal Paoli revient sur l’île. Il présidera le Conseil Administratif et assurera le commandement en chef des Gardes Nationales. Ces Gardes étaient engagées dans la région pour réprimer les menées contre-révolutionnaires déclenchées par le clergé réfractaire local. La Monarchie constitutionnelle s’est effondrée, et la Constitution civile du clergé est proclamée et appliquée, ce qui a eu pour conséquence de faire fuir de l’île de nombreux prêtres réfractaires et des nobles. Dans l’île, les clivages royalistes et révolutionnaires s’amplifient. En effet, à la Révolution de 1789, succède en 1790 et en 1791 une contre-révolution de royalistes soutenue par Paoli, et une forte protestation à la Constitution civile du clergé. Bastia est investie et sa municipalité est suspendue ; le siège du gouvernement de l’île, de l’Evêché et, le chef-lieu du département sont transférés à Corte. En raison, de « l’affaire de Sardaigne », le Comité de Défense Nationale a entrepris de lancer une expédition en Sardaigne. Paoli est jugé par Marat de «lâche intrigant», car peu d’hommes sont envoyés en Sardaigne, et il est alors suspendu de son commandement. Paoli fait sécession. Il entre en dissidence contre la convention et se rallie à ses anciennes idées anti-françaises. Les partisans de la Révolution, notamment Napoléon, sont menacés par Paoli et ses hommes. En 1793, Paoli est désigné comme traître à la Nation. Concernant les troupes militaires, le régiment Royal Corse d’infanterie (Troupes légères), fut dissout par ordonnance royale le 17 mars 1788. C’est cette même ordonnance qui décida la séparation des chasseurs à pieds et à cheval. Le Royal Corse fut donc transformé en 2 bataillons de chasseurs à pieds portant les numéros 3 et 4 et les titres de Bataillon de Chasseurs Royaux Corse N°3 et Chasseurs Corses N°4. Ces bataillons avaient 4 compagnies de 6 officiers et 102 hommes disposant de 12 carabiniers et étaient commandés par un lieutenant-colonel. B . L’intermède anglais. Dès lors, l’île est à nouveau en prise aux querelles et aux combats, car Paoli fervent partisan de la monarchie constitutionnelle, a fait appel à l’Angleterre. Progressivement les villes tombent comme Saint Florent et Bastia en mai 1794. Bastia, qui était restée une place forte aux mains des français, résistera 3 mois au siège de la marine anglaise et au siège des insulaires venus de l’intérieur des terres. Des militaires se sont illustrés, pour avoir pris part à la résistance contre l’occupation anglaise ; il s’agit de Franceschi qui a pris part comme adjudant de la place de Saint Florent aux côtés de Gentili. Franceschi que l’on retrouvera lors de la campagne d’Italie. Avec la chute de Calvi et grâce à la flotte anglaise commandée par Nelson, la France a perdu son contrôle sur la Corse.
Les liens avec la France sont rompus et une nouvelle Constitution démocratique et libérale est votée. L’île appartient désormais au Royaume d’Angleterre, et Sir Elliot en devient le Vice Roi. Mais la politique contre révolutionnaire qui est menée décevra les habitants de l’île : Paoli devra s’exiler de nouveau. Les armées françaises s’illustrèrent lors de la campagne d'Italie, et la signature de la paix avec la Sardaigne inquiète l’Angleterre, qui estime qu’elle est « contrainte de retirer aux Corses la protection qu’elle leur a accordée pour les amener à s’affranchir de la tyrannie du gouvernement français ». Deux officiers s’illustrèrent dans l’expulsion des anglais de l’île : le général Casalta et le général Antoine de Gentili. Apparaît alors Bonaparte qui voulait que la Corse devienne définitivement française, et qui confia cette mission au général Gentili. On peut quand même évoquer brièvement que différentes unités militaires virent le jour sous les couleurs du drapeau anglais. Il en a été ainsi du Bataillon royal anglo-corse, un régiment corse qui a été formé par le général Sir Charles Stuart, et qui était composé de Corses issus des bandes indisciplinées de Paoli. Ce régiment était composé de 3 bataillons de 500 hommes chacun. Ces bataillons ont aidé la gendarmerie pour des opérations impopulaires, telles que le recouvrement des impôts. Et il est également intéressant de citer le Royal Corsicans Rangers, ou le régiment des Francs Tireurs Royaux Corses ; il s’agit des troupes militaires composées de réfugiés politiques venus de corse. La levée du premier corps de ce régiment se déroula en 1799. Le second corps est levé en 1804. Cette unité est appelée Royal Corsicans Rangers et a participé glorieusement à la victoire de Maïda (Naples) avec les troupes anglaises.
C. A propos des bâtiments militaires de la ville. A la fin du XVIIIème siècle, Bastia compte, une vingtaine d’édifices religieux, dont dix couvents. Avec la Révolution, de nombreux édifices religieux, et plus particulièrement les couvents, furent réquisitionnés par l’armée. Ils connurent dès lors de nombreuses transformations, puisqu’ils furent aménagés en casernes, entrepôts, manutentions, hôpitaux... Il paraît important de rappeler qu'au XVIIIème siècle, Bastia ne comptait pas le tiers de sa superficie actuelle. Au nord, la ville de Bastia s’arrêtait d’un côté à la chapelle Saint Roch (sise rue Napoléon) et de l’autre, au couvent des Missionnaires. La Place Saint Nicolas n’existait pas encore. Le couvent des missionnaires, après la conquête en 1769 et surtout sous le gouvernement de Marbeuf, connut des transformations importantes. Marbeuf, alors Gouverneur français de l’île, y installa dans une aile le siège du gouvernement, alors que pendant la période génoise, le gouvernement siégeait au Donjon de la Citadelle. Puis, durant l’occupation anglaise, ce couvent devint le Palais du Gouvernement ; sous le Directoire, le Consulat et l’Empire, il fut érigé en préfecture, puis en sous-préfecture lorsque Bastia est devenue chef-lieu du département du Golo. Il fut ensuite transformé en Mairie, puis devint le siège de la Cour d’Appel jusqu’à la construction du Palais de Justice actuel à la fin du XVIIIème siècle. Au début du XXème siècle, le couvent est devenu une caserne qui logeait les soldats du 173ème régiment d’Infanterie et les batteries d’artilleries.
Ensuite, ce couvent est devenu le Lycée Marbeuf et actuellement le Lycée Jean Nicoli. Le couvent Saint François et le Couvent Saint Angelo, qui connurent à partir de la Révolution d’importantes modifications sont implantés dans la "terra vecchia". Le couvent Saint Angelo des franciscains réformés a été définitivement utilisé par l’armée dès la révolution. Néanmoins, auparavant, il avait déjà été réquisitionné par des unités militaires. En 1731, lors de la révolte qui agite la Corse, l’Empereur allemand envoie des troupes pour mâter la rébellion, et les soldats allemands furent logés dans une aile du vaste couvent. Puis, en 1747, des militaires sardes l'occupèrent (il s’agit des troupes de Rivarola, un Corse au service du roi de Sardaigne qui assiégèrent la ville et la Citadelle puis quittèrent la ville en septembre 1747.). En 1765, des militaires français s’y installèrent, envoyés par le roi de France à la demande de la République de Gênes pour assurer des missions de conciliation et d’arbitrage. Puis en 1777, lors des Etats de Corse organisés par Louis XVI et en 1789, les pères réformés se plaignirent de ce que les bâtiments soient occupés par les troupes du Roi sans percevoir aucune compensation en retour. En effet, seule une partie du second étage du couvent était occupée par les moines; en outre, la cour intérieure leur avait été retirée par la municipalité pour servir de cimetière.
Sous l’ancien régime, ce couvent était dénommé couvent Saint Ange. Avec la Révolution et les lois de 1791 qui transfèrent à l’Etat la pleine propriété des édifices religieux, les franciscains sont définitivement chassés du couvent. L’armée l’utilise alors comme caserne, et les bâtiments prennent le nom de «caserne Saint Ange» ou «caserne Sant’Angelo», d’après les archives du Service Historique de l’Armée de Terre (SHAT) de Vincennes. Dès 1797, l’armée va entreprendre des travaux importants et les trois étages seront occupés par des militaires. Vers 1800, la nef de l’église Saint Michel Archange est transformée en dortoir. En 1802, des travaux de réaménagement sont entrepris. et en 1816, les militaires rédigent un descriptif de la caserne. En 1826, la caserne Sant’Angelo, cotée 42, d’après les plans du Génie militaire, abrite sous Charles X , 402 hommes d’infanterie. Sous le règne de Louis Philippe, en 1839, l’armée prévoit de grands travaux de restauration avec l’édification de contreforts, mais, l’état de certains bâtiments conventuels nécessite leur destruction. Seule l’aile de l’Eglise sera conservée. A la fin du XIXème siècle, trois corps de bâtiment qui menacent de tomber en ruine sont détruits. En 1848, l’église devient un entrepôt à blé et elle perd son fronton, la partie supérieure est désormais horizontale. Ainsi, la partie subsistante, l’aile de l’Église à laquelle on adjoint une construction neuve, est transformée en entrepôt de vivres et devient « la manutention militaire de Saint Angelo ». Dans les documents du Génie militaire, conservés au SHAT à Vincennes, se trouvent des plans attestant la volonté de mettre en place un entrepôt à blé.
En 1855, sous Napoléon III, le service de l’armée de la manutention des vivres installé dans ce qui deviendra l’Hôtel de ville, est transféré à Saint Angelo. C’est à cette époque que de nombreux travaux d’agrandissement de la ville ont été entrepris. Jusqu’à l’acquisition du bâtiment par la municipalité en 1993, ce dernier demeure la manutention où sont entreposées les vivres et où étaient les cuisines et la boulangerie de la garnison. En 1999, des travaux d’aménagements sont réalisés par le cabinet Atlas Architecture de Bastia. Actuellement, le couvent abrite « la maison des associations ». Le deuxième bâtiment religieux de la ville qui a connu une métamorphose complète est le couvent Saint François. Ce couvent des "Franciscains Observants" a longtemps servi d’hospice, et, dès 1745, les termes "couvent" et "hôpital" ont été associés, selon une légende d’un plan du Génie des archives militaires françaises conservé au SHAT de Vincennes. Il semblerait en effet, qu’à cette époque, une aile ait été réservée à des soldats malades. En 1755-1769, époque de la "Corse indépendante", il semblerait que son importance religieuse ait diminué à mesure que son rôle et ses fonctions militaires croissaient. En 1777,du temps de Marbeuf, alors que la Corse est devenue française, une partie de cet édifice reçoit l’affectation d’hôpital et porte le nom de "couvent hôpital militaire de Bastia". C’est avec la loi du 10 juillet 1791 que la pleine propriété des édifices religieux a été transférée à l’État; le Couvent Saint François a été laïcisé et est entièrement transformé en hôpital militaire.
En 1796, Bastia ne connaîtra plus d’expédition des forces militaires d’autres pays et la ville devient la Préfecture du département du Golo de 1800 à 1811. En 1810, sous le second Empire, l’hôpital militaire est de nouveau transformé pour accueillir des malades en plus grand nombre. En 1815, après la Restauration, Bastia est soumise au bon vouloir de l’autorité militaire; Les habitants de la ville coexistent difficilement avec l’armée. L’urbanisme est contrôlé par le Génie qui a acquis une grande importance; la municipalité voit la plupart de ses projets rejetés. De 1822 – 1828, le Génie fait entreprendre des grands travaux de consolidation de l’hôpital militaire. En 1845, l’hôpital militaire sera baptisé l’hôpital Rosagutti, du nom d'un chirurgien mort à Sidi Brahim.
En 1939, l’hôpital Rosagutti est devenu l’hôpital annexe, au bénéfice de celui d’Ajaccio qui est désormais devenu l’Hôpital principal. Après la fermeture de l’hôpital militaire le 30 mars 1984, le couvent a servi à héberger les services fiscaux puis des associations dont la FALEP, U MARINU, BASTIA ACCUEIL qui occupent une partie du rez-de-chaussée. Toutefois, ce bâtiment, laissé à l’abandon, nécessite une véritable rénovation et réhabilitation, car les locaux sont insalubres et rongés par les termites ou autres insectes nuisibles. De nombreux projets de reconversion du bâtiment sont encore à l'étude. IV . Du directoire à la Corse contemporaine. Bonaparte a permis la reconquête de la Corse. Cependant de nombreux Corses étaient choqués des prises de position de la France sur la religion et notamment par la chasse aux émigrés et aux prêtres réfractaires. En outre, le nouveau régime imposa de nouvelles mesures fiscales maladroites, et de nombreux abus ont été commis par les forces de l’ordre. A . La révolte de "la Crocetta" en 1797.Il est intéressant de rappeler ce fait historique, qui s’est déroulé sous le Directoire, puisque les armées ont de nouveau agi pour étouffer et réprimer une révolte. Certains la nommèrent la croisade tentée par le clergé réfractaire. De nombreux Corses patriotes, admirateurs de Paoli, n’admettant pas la constitution civile du clergé se sont mobilisés afin de se soulever contre le régime en place. L’insurrection a démarré en décembre 1797, suite à un décret ordonnant la déportation des prêtres réfractaires dans le département du Liamone et du Golo. Les insurgés firent appel à d'anciens chefs du parti français de 1768, le comte Mattéo Buttafuocco et Giafferi "le Brigadiere", ancien général de Brigade à Naples. Leur volonté était de mettre à mal un régime aussi odieux que celui de Gênes qui opprimait la religion. Cette révolte se dénomma la révolte de la Crocetta contre laquelle on envoya en premier lieu, le Général Casalta. En effet Casalta avait été mis en place dans l’île comme commandant militaire de la Corse au début de l’année 1797, après l’expulsion des anglais. Puis malade et fatigué, il fut remplacé par le Général Vaubois ; ce dernier mit fin à la révolte des insurgés en février 1798. B. Du Consulat à L’Empire. Après cet épisode, s'en suit le Consulat et l’après 18 brumaire an VII . En 1797, le premier consul voulait que la Corse soit rattachée à la République. En 1800, ses idées étaient les mêmes : il voulait que les Corses deviennent des Français à part entière. Pour cela, des administrateurs furent nommés, au premier rang desquels figurent Miot et le général Morand. Les bataillons d’infanterie légère de chasseurs corses formés en juillet 1802 (le 2ème bataillon était à Bastia) devinrent en septembre 1805 les Bataillons des Tirailleurs Corses. En juin 1803, la levée de 5 bataillons d’infanterie légère corses fut décidée ; ils deviendront, en mai 1805, la Légion Corse, connue aussi sous le nom de Real Corso. En mai 1805, un décret met en place des compagnies départementales de réserve : une pour le Liamone et une pour le Golo ; ces unités se composaient d’anciens soldats libérés de plus de 5 ans de service. Elles fournissaient un service de garde sédentaire, ou d’honneur, auprès des préfets. En 1805, dans la 23ème division militaire, 2 bataillons composés de 5 compagnies de 100 hommes furent levées et rattachés à la Légion corse : un du Golo et un du Liamone. Fin 1805, ces bataillons de chasseurs corses furent employés dans leur département ; ils participèrent aux expéditions contre les opposants politiques ou les malfaiteurs et aux opérations de défense contre les tentatives anglaises sur les côtes. En 1810, la gendarmerie de l’île a été complétée par des hommes issus des trois bataillons corses licenciés précédemment. Sous l’Empire, de 1801 à 1811, la Corse est mise en quelque sorte « hors la loi ». En effet, en 1800, sous le Directoire, Bonaparte décida de donner à l’île un statut spécial, comprenant que l’île était marquée par des particularismes : la Constitution de l’an VIII est suspendue dans les deux départements. Le général Joseph Morand est nommé en 1801 en remplacement de Muller dont Miot a demandé le départ. Par un arrêté de janvier 1803, a été confiée à Morand la responsabilité en tant que général en chef commandant de la 23ème division militaire, la responsabilité de l’exécution des lois et des textes de toutes sortes qui régissent la Corse. Il a ainsi eu la responsabilité de procéder à l’arrestation des délinquants et de les traduire devant les tribunaux, de veiller au désarmement des fauteurs de troubles et de faire appliquer la circonscription. Un régime de dictature militaire va régner. Les commissions militaires se multiplient. On trouve partout dans l’île des corps de troupes. Il y a 5 Bataillons de Chasseurs Corses mais également le bataillon des Tirailleurs Corses et la Légion Corse; pour assurer le maintien de l’ordre, il y a les colonnes mobiles de la Gendarmerie Nationale. Les chasseurs corses sont organisés par Morand. Quant aux Tirailleurs corses, leur création remonte à 1805, c’est Napoléon qui ayant constaté les vertus guerrières des Corses, décida de mettre en place un nouveau corps. Mais Morand n’est pas apprécié par la population, on parlera même d’une "Giustizia Morandina". En 1804, on frôlera le risque d’un "péril vendéen" en Corse. En 1811, Napoléon le fait rappeler et Morand est remplacé.
Durant cette année 1811, se sont déroulés différents évènements. Les deux départements du Liamone et de Golo fusionnent ; désormais le Préfet ne siègera plus à Bastia, mais à Ajaccio, nouvelle capitale administrative et religieuse. Le chef-lieu de la Corse, Bastia, devient la sous préfecture de l’Empire. Par contre, le chef-lieu de la division militaire et la cour royale, demeurent à Bastia. Cette situation perdurera pendant un siècle et demi, ce qui a eu des conséquences économiques et démographiques fâcheuses pour Bastia. Napoléon qui avait prescrit aux hommes d’église, prêtres et prélats de prêter serment fut contraint d’en reléguer certains en Corse pour y être punis et emprisonnés, soit quatre cents environ qui voulaient rester fidèles au pape : ils furent envoyés à Calvi, Corte et Bastia… Ces relégations ne furent guère appréciées des insulaires très fervents qui furent très critiques à l’encontre de l’Empereur. Le 11 avril 1814, jour de l’abdication à Fontainebleau, une insurrection éclate à Bastia. A ce moment, les insurgés ignorant la situation qui se déroulait sur le continent, réussirent à se faire ouvrir les portes de la Citadelle, emboîtèrent le pas aux gardes nationaux et désarmèrent la garnison qui tenait place dans la Citadelle. C. De la restauration à la troisième République. Louis XVIII, remonté sur le trône, ne verra pas son royaume amputé de la Corse. Un nouveau commissaire des Bourbons arrive alors en Corse. Le 14 juin 1814, Louis XVIII octroie aux français une charte qui apporte de profondes modifications à l’état de la législation, notamment l’égalité devant la loi et l’instauration des jurys dans les cours de Justice ; cette dernière mesure ne fut cependant pas appliquée dans l’île où il existait une cour de justice criminelle. A la seconde restauration, en septembre 1815, une ordonnance royale crée les Légions Départementales d’Infanterie qui avaient pour mission de rétablir l’autorité royale et de maintenir l’ordre dans la situation troublée qui avait marqué le second effondrement de l’Empire après Waterloo (terreur blanche, épuration des fonctionnaires…). En Corse, les deux bataillons de chasseurs corses organisés en 1814 étaient restés dans l’île ; ils furent dissous comme corps, mais entrèrent en unités constituées dans la Légion départementale. La Légion départementale de Corse, troupe d’infanterie spéciale de Corse, a été un corps de transition entre deux époques de l’histoire militaire. Elle devait prendre le numéro 54, mais son caractère particulier ne le lui permit pas ; en effet, la Légion départementale de Corse était employée comme auxiliaire de la gendarmerie royale de l’île : ses missions étaient la répression du banditisme endémique dans les montagnes, et le service des places de l’île. En 1820, la Légion Corse a été dissoute conformément à l’ordonnance royale du 23 octobre 1820 : l’armée a été réorganisée selon un système régimentaire et voit la formation du 10ème régiment d’infanterie légère. Le 5 août 1830, on apprend à Ajaccio les évènements des 27, 28 et 29 juillet à Paris ; ces « trois glorieuses » consacrèrent le renversement du Roi Charles X. C’est Louis Philippe, « le prince citoyen » qui lui succèdera. En 1838, d’après une description de l’île réalisée par Abel Hugo, le frère de Victor Hugo, dans le Tome I, il est stipulé que la Corse forme la 17ème division militaire ; le lieutenant-général, commandant la division réside à Bastia ; il se trouve également à Bastia une direction du Génie et le chef-lieu de la 17ème légion de gendarmerie. La Garde Nationale a été supprimée. Arrêtons-nous un instant sur l’histoire de la force publique en Corse, qui a tenu un rôle important. Il était indispensable qu’en Corse l’ordre public soit préservé ; en effet, la rivalité des factions et les ambitions de leurs chefs s’entrechoquaient souvent dans l’île. La maréchaussée royale, troupe militaire de sûreté, puis la gendarmerie qui lui succéda, furent insuffisantes. Les gouvernements successifs de la France firent donc appel à des troupes auxiliaires de Force Publique pour mener à bien la pacification de l’île. Ce furent des troupes de recrutement corse qui ont été employées à ces missions ; de 1772 à 1850, ces troupes ont été employées comme force publique de souveraineté française. De 1772 à 1791 le Régiment Provincial Corse a accompli des missions de force publique locale. Le Provincial Corse doit être considéré comme ayant assuré complètement le service dévolu de nos jours à la Gendarmerie. Le 16 février 1791, la Gendarmerie Nationale est créée à partir de la maréchaussée royale et des diverses autres prévôtés du Royaume. En Corse, il s’agissait de la 28ème Division de Gendarmerie. En 1801, sous le Consulat, la gendarmerie a été réorganisée, la Légion a été substituée à la Division de 1791. De 1803 à 1814, les chasseurs corses, et de 1815 à 1820, la légion départementale de Corse, servirent de troupes de maintien de l’ordre public. En plus de ces formations, existaient des services temporaires de colonnes mobiles levées pour des actions de répression du banditisme. En 1822, la Gendarmerie Royale de Corse leva des anciens soldats corses volontaires ; il s’agissait de la création des Voltigeurs corses, lequel a été engagé comme troupe auxiliaire de la Gendarmerie : son recrutement était local pour la troupe. De 1822 à 1850, on parla du Bataillon d’élite des Voltigeurs corses. L’année 1850 marqua la fin de la dernière troupe corse. Les Voltigeurs Corses furent intégrés dans la Gendarmerie. Dès 1850, des soldats furent engagés comme gendarmes à part entière (Bataillon de Gendarmerie mobile de la Corse). L’essor de l’urbanisme au milieu du XIXème siècle donne à la ville son aspect actuel. En 1830, dès la Monarchie de Juillet, l’urbanisme s’intensifie, de grands travaux d’aménagement de la ville ont été entrepris et transformèrent complètement la configuration de la ville. C’est à cette époque que les travaux de construction de la place Saint Nicolas (place Louis Philippe) et le boulevard Paoli (traverse n°1) traversant la basse ville et la haute ville débutèrent. Sous le Second Empire, de nombreux travaux ont été poursuivis et intensifiés : il s’agissait de travaux d’aménagement de voirie (rue César Campinchi). De 1852 à 1856, le nouveau palais de justice a été construit. Mais c’est sous la IIIème République, avec les grands travaux de la construction du théâtre, que la rue César Campinchi, parallèle au boulevard Paoli, prit son aspect définitif. D. La guerre de 1870.Durant cette campagne, les Corses ont été fortement impliqués. Un régiment provisoire de mobiles de la Corse à 2 bataillons a été crée par le lieutenant colonel Parran, chef de corps. Ce régiment appartenait à la première brigade de la 3ème division d’infanterie, 20ème Corps d’Armée. Il y a eu en Corse des tentatives infructueuses d’organisation de corps francs. Des recrutements de volontaires républicains corses furent prévus en 1870, mais à cause des démêlés entre bonapartistes et républicains, le recrutement s’avéra difficile. Ce qu’il apparaît le plus souvent et qui est un fait marquant, c’est que de nombreux jeunes corses ont été enrôlés dans les troupes continentales. Pour la première fois, il n’y a pas eu de mise sur pied d’unités spéciales composées de Corses. En 1870, la Corse française était totalement intégrée dans l’armée française. La loi sur l’organisation de l’armée en 1873 prévoyait la réorganisation des forces armées, et la loi des cadres qui la compléta permit de régler l’emploi des ressources en hommes ou en armes. Deux niveaux de répartition territoriale avaient été crées : un niveau national pour l’armée active mise sur le pied de paix, et un niveau régional pour la mobilisation mise sur le pied de guerre. A cette époque, l’infanterie représentait plus de 80% des effectifs mobilisables. Le découpage du territoire en subdivisions comprenait 1/8 de région. Il y eut ainsi création d’un régiment d’active et un de réserve. La Corse faisait partie de la XVème région Militaire qui avait son chef-lieu à Marseille ; cette région militaire était composée de 9 subdivisions, 8 sur le continent et une en Corse. Au départ, en 1873, en Corse, il y avait des bataillons détachés des régiments du continent pour tenir ses garnisons. En 1890, un régiment d’active d’infanterie (N° 163), fut créé (il portait le képi rouge à bandeau bleu) pour la défense de la Corse contre une attaque éventuelle de l’Italie alliée de l’Allemagne et de l’Autriche Hongrie. Ce 163ème Régiment d’Infanterie à 4 bataillons, a été réparti entre les garnisons de l’île, pour la défense des côtes mais aussi vers l’intérieur.
E. Les deux guerres mondiales. La première guerre mondiale : A la veille de la grande guerre, Albert de Mun a écrit dans l’écho de Paris : « l’Europe toute entière, incertaine et troublée, s’apprête pour une guerre inévitable, dont l’heure lui est cachée, dont la cause lui demeure encore ignorée, mais qui s’avance vers elle avec l’implacable sûreté du destin ». Durant cette guerre, les troupes installées en Corse prirent une part significative dans le conflit. Le 173ème Régiment d’Infanterie était prévu par la loi des cadres du 23/12/1912, il est constitué à Nice en avril 1913 : il est formé de 4 bataillons, soit 16 compagnies. En septembre 1913, cette nouvelle unité tient garnison en Corse, à la caserne Marbeuf comme cela a été sus évoqué. En effet, en septembre 1913, le 173ème R.I. (Régiment d’Infanterie) permuta avec le 163 R.I. ; il se rattachait aux traditions d’une demi brigade de Bataille des armées de la Ière République dans l’organisation de 1793 à 1796. A Bastia il y avait : le colonel, le drapeau, l’état-major et le 4ème bataillon. Le 1er août 1914, le lieutenant-colonel Chatillon reçoit à Bastia, le télégramme ordonnant la mobilisation générale. Ce régiment, qui jusqu’alors était composé de continentaux, devint un régiment composé essentiellement de Corses, les réservistes de l’île y étant incorporés. L’ensemble des troupes est regroupé à Ajaccio et embarque pour le continent. Le 20 août 1914, s’est déroulée la bataille de Lorraine, à Dieuze ; les morts sont nombreux, le 173ème a perdu la moitié de ses effectifs. De septembre à novembre 1914, le régiment fut envoyé sur le front de la Marne. Des blessés sont ramenés à Bastia, tandis que de l’autre côté de la mer «aio zitelli» continue la bataille. Puis le 173ème est envoyé sur d’autres batailles. Il est endivisionné en 1914 au sein de la 30ème Division d’Infanterie, la 12ème D.I. en 1915 et la 126ème D.I. en 1916. Le 173ème a participé à la guerre des tranchées qui s’est déroulée de 1915 à 1917. En juin 1916, le 2ème bataillon et la 3ème compagnie de mitrailleurs du 173ème R.I sont cités à l’ordre de l’armée par le général commandant la IIème armée. En janvier 1917, le 173ème est cité à l’ordre de l’armée. A Verdun, sur la rive droite de la Meuse, de janvier à août 1917, le régiment démontre sa bravoure et son entrain permet d’enlever des positions à l’ennemi. Le général Pétain, commandant en chef, confère au drapeau du régiment la fourragère aux couleurs de la croix de guerre. La deuxième campagne de Lorraine d’octobre 1917 à juin 1918 conduit à l’offensive victorieuse. Le 173ème est retourné à Dieuze pour aller en juin 1918 aux portes de Compiègne. En juillet 1918, Foch est promu maréchal de France. A nouveau, par deux fois, en septembre et novembre 1918, le régiment est cité à l’ordre de l’armée par le général commandant la Ière armée. Le 11 novembre 1918, le 173ème, alors à Tupigny, apprend la signature de l’armistice à Rethondes dans la forêt de Compiègne. Le 13 novembre, par ordre n° 134, la fourragère aux couleurs du ruban de la médaille militaire lui est conférée. Le 28 juin 1919 les 435 articles du traité de paix sont signés. Les hostilités sont arrêtées. Le 173ème stationne à Wiesbaden (Allemagne). En janvier 1920, l’état-major du régiment et les états-majors des 2ème et 3ème bataillons et le drapeau débarquent du bateau le Corte II, à Bastia. « De retour après plus de 2000 jours d’absence, le drapeau du 173ème porte dans ses plis, le souvenir de 77 officiers, 263 sous-officiers et 3021 hommes de troupe tombés au champ d’honneur. ». De nombreuses familles corses ne revirent plus leurs enfants morts pour la patrie. En outre, la mobilisation d’août 1914, avait mis sur pied de guerre en Corse, deux régiments, en supplément du 173ème R.I :
Le 373ème R.I. fit campagne comme le 173ème. Par contre le 116ème régiment territorial d’infanterie était composé d’officiers et de sous-officiers corses de carrière, retraités dans l’île. C’est lui qui assura la relève du 173ème R.I. dans sa fonction de défense de l’île. Puis il fut envoyé sur le front de France et alla faire campagne dans le Sud Tunisien. En mars 1920, le 173ème R.I. fut reconstitué en Corse, deux mois après le retour du drapeau, avec de nouvelles recrues. A Bastia, s’installe l’état-major, la compagnie hors rang et le 1er bataillon. Le régiment compte environ 1000 hommes et est composé de trois bataillons. La devise pour le Ier est « toujours plus haut ». Pour le 2ème, la devise est « mieux qu’hier », et pour le 3ème « je veille ». En février 1926, le ministre de la guerre décida de transformer le 173ème R.I en régiment de type montagne ; il fut donc classé dans l’infanterie Alpine tout en demeurant dans l’île. Il est intéressant d’évoquer qu’en 1934, le régiment est venu prêter main forte aux populations, assurant en cela des missions que l’on dénommerait de nos jours, missions de sécurité civile ; en février 1934, une tempête de neige s’était abattue sur la Corse causant de nombreux sinistres : Une avalanche avait détruit le village d’Ortiporio, écrasant 8 maisons et ensevelissant 38 personnes. Le préfet de Corse félicite pour son action, le 173ème Régiment d’Infanterie Alpine. Puis ce régiment fut mobilisé une seconde fois en septembre 1939 et il constitua la 173ème Demi Brigade d’Infanterie Alpine. Au cours de la période d’entre-deux guerres, à Bastia, le développement urbain s’amplifiera, les quartiers du nouveau port et de Toga se construiront. Bastia, de petite bourgade de 700 personnes en 1600, de 6000 habitants en 1650, de 18000 habitants en 1860, passe en 1936 à environ 50 000 habitants. La deuxième guerre mondiale. Durant cette guerre et notamment en 1943, Bastia, occupée par les S.S allemands et les fascistes italiens, va subir de nombreux bombardements. En septembre 1943, les Allemands bombardent le Fort Lacroix et le vieux port. Puis les quartiers de la gare et du nouveau port seront détruits par d’autres bombardements de la R.A.F et de l’U.S Air Force. Bastia est la dernière ville de l’île à être libérée, le 4 octobre 1943 ; les pertes furent importantes et de nombreux bâtiments furent détruits (palais de justice, théâtre municipal) ainsi que le cimetière. La participation de l’armée dans cette guerre se déroula comme suit : fin mai 1940, la 173ème Demi Brigade Alpine (DBA) fut expédiée en France en renfort. Engagée dans une bataille en Champagne, elle mena les derniers combats avant de disparaître dans l’effondrement du front. Le 17 juin 1940, le Maréchal Pétain demande de cesser le combat. Le lendemain, le Général de Gaulle encourage par son célèbre appel à continuer la lutte contre l’envahisseur. Le 18 juin, 72 rescapés du 3ème bataillon sont faits prisonniers dans l’Yonne. Le 22 juin, l’armistice est signé à Rethondes. Le reste de la 173ème Demi Brigade Alpine va être regroupé au camp de la Courtine, 13ème région militaire. Les rescapés sont moins de 300, il y a 32 officiers, 34 sous-officiers et 205 soldats. On compte 367 prisonniers et 713 disparus. Le 30 juillet 1940, la 173ème D.B.A est dissoute. Les rappelés sont démobilisés, alors que les officiers rejoignent le 5ème R.I, les sous officiers le 72ème R.I et la troupe le 17ème B.C.P. Cependant, après l’armistice du 22 juin 1940, une armée de transition française est reconstituée, avec l’accord de l’Italie et de l’Allemagne. Dans l’île, cette armée portera le nom de 173ème Bataillon Autonome de la Corse. Le 173ème B.A.C. est formé le 26 juin à partir des militaires corses démobilisés en nombre depuis la fin des hostilités ; ce sont des militaires d’armes diverses et surtout des appelés. A Bastia, se trouve le P.C du bataillon, avec comme chef de corps le commandant Moretti. A la caserne Marbeuf de Bastia, on trouve l’état-major, le commandement, le peloton de mortiers, la 2ème Compagnie, et à St Joseph, les, 1er , 3ème et 4ème compagnies. A Tattone, les sapeurs et les militaires sont affectés à l’aménagement d’un camp alpin. A Ajaccio, la citadelle est occupée par un détachement. Les unités s’instruisent et s’entraînent avec les armes dont elles disposent. Les ordres sont clairs : s’opposer à toute tentative de débarquement en Corse. En septembre 1940, les matériels de transmissions sont soustraits au contrôle de la commission italienne d’armistice par le lieutenant Berti ; des postes sont cachés dans une double cloison de la caserne Marbeuf. La bataille d’Angleterre et la contre-offensive britannique en Cyrénaïque se déroule pendant cette période. La Yougoslavie et la Grèce vont être envahies par les troupes d’Hitler. Le siège de Tobrouk, l’invasion de l’U.R.S.S, l’entrée en guerre du Japon et Pearl Harbor vont entraîner les Américains dans la guerre. Le 2 janvier 1942, le commandant Guillaud remplace le commandant Moretti à la tête du 173ème B.A.C. Le 8 mai 1942, Français et Anglais entrent à Tunis tandis que les Américains sont à Bizerte. Le 13, toute résistance a cessé en Afrique, les alliés vont pouvoir se diriger vers la Sicile, l’Italie et la Corse. A Casablanca, le général Henri Martin constitue la 4ème division marocaine motorisée, sur le type montagne. Le 11 novembre 1942, le drapeau du 173ème est mis en lieu sûr pour le protéger. La subdivision militaire de la Corse est commandée par le général Humbert ; afin d’éviter que ses troupes soient désarmées par les Italiens, il les cantonne à l’intérieur de l’île : la 1ère compagnie demeure installée à Bastia sous sa garde. Le 27 novembre 1942, la flotte s’est sabordée à Toulon : les armes lourdes et légères sont détruites car les Italiens avaient encerclé les bâtiments militaires pour s’en emparer. Le général Humbert ordonne la dissolution du 173ème B.A.C ; les hommes sont renvoyés chez eux avec armes et matériels. Dans l’ordre du jour du 04 décembre 1942, le général Humbert signale : « … depuis l’armistice nous avons formé des unités solides et disciplinées, …le 173ème B.A.C compte parmi les plus belles. Pour tous les efforts que vous avez fournis pendant ces deux années, pour tous les résultats que vous avez obtenus, je vous remercie au nom du pays. Vous pouvez être fiers... ». La majorité des hommes démobilisés passent dans la clandestinité. Le général Delmas avait écrit en s’adressant aux jeunes soldats du 173ème B.A.C, récemment crée : « j’atteste solennellement la vaillance au feu des Corses qui furent engagés sur le front de l’Aisne, Ils ne furent nulle part enfoncés, ils ne se replièrent que sur ordre, étant déjà encerclés… jeunes soldats, vous êtes les héritiers de vieilles traditions militaires de la Corse. »
Le 11 décembre 1942, le sous marin Casabianca, qui lors du sabordage de la flotte, avait forcé les filets de la rade de Toulon, est envoyé en Corse depuis Alger, pour prendre contact avec les patriotes dirigés par Fred Scamaroni. En 1943, le 173ème est reconstitué grâce à l'incorporation des maquisards corses qui avaient repris les armes contre les occupants allemands et italiens. Son drapeau, caché dans une oubliette du grenier d’une église, fut restitué par le général Martin, commandant les troupes venues d’Afrique après la libération de Bastia. La libération de l'île s'est achevée avec la reconquête du port de Bastia. La Corse est le premier département français libéré. L’année 1945 fut marquée par la démobilisation et par la disparition de l’organisation subdivisionnaire militaire de la France.
BIBLIOGRAPHIE
|